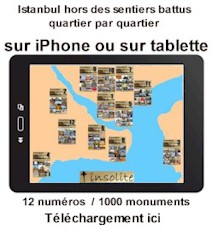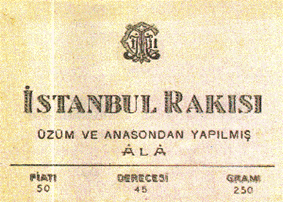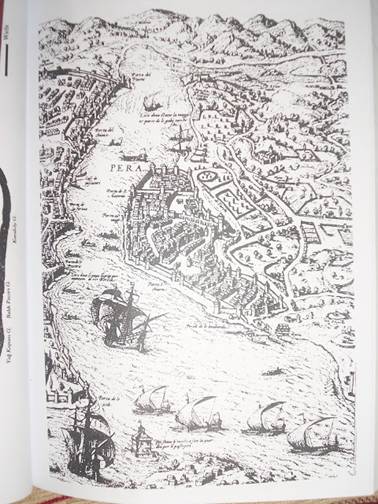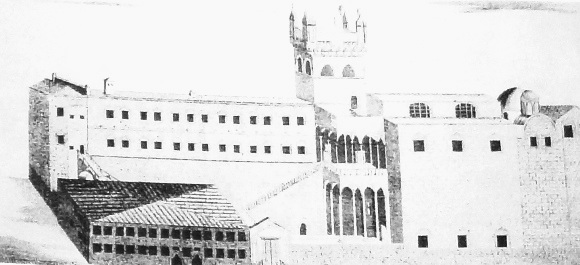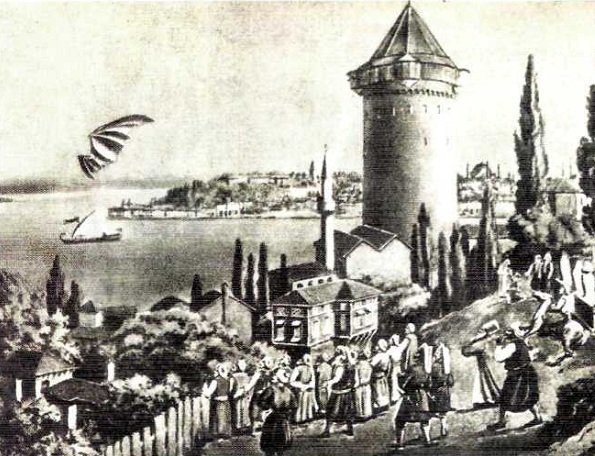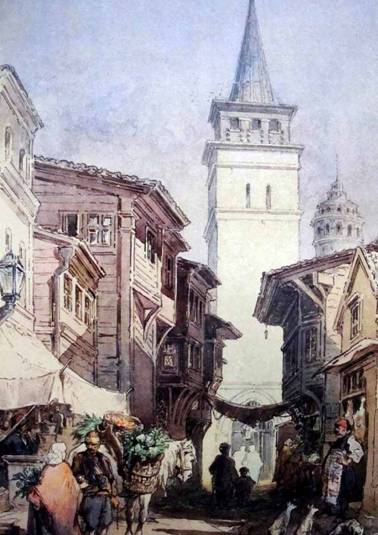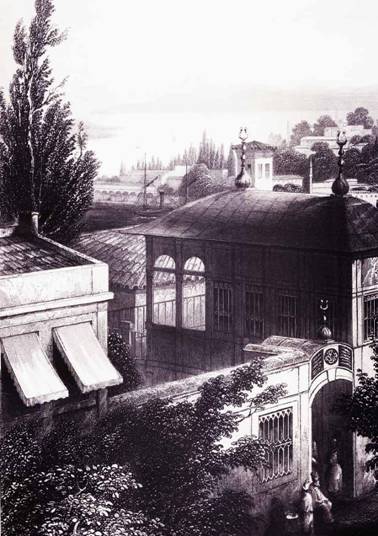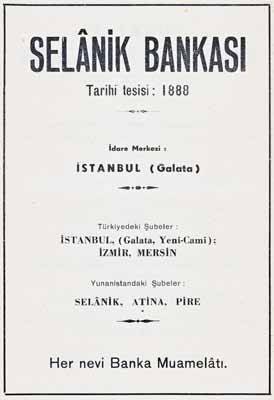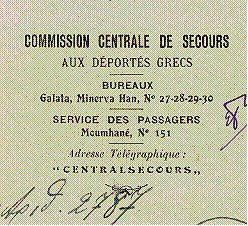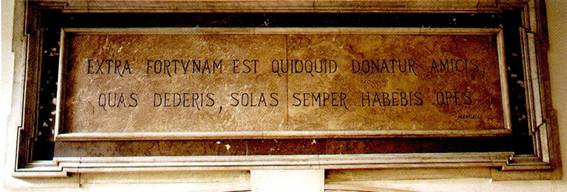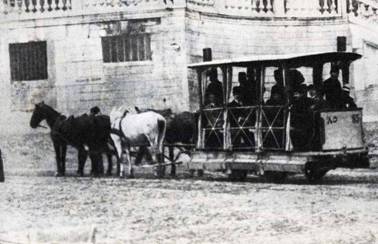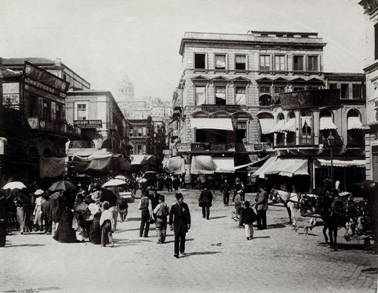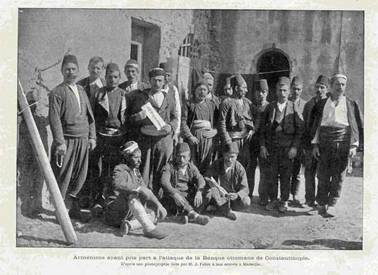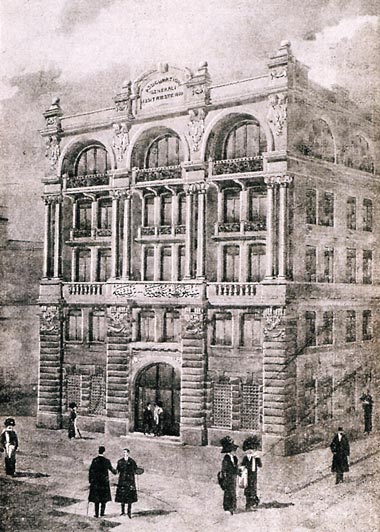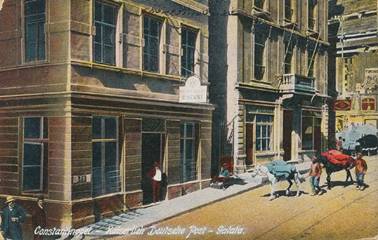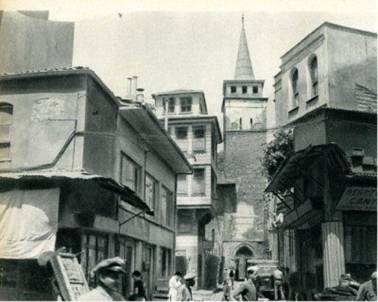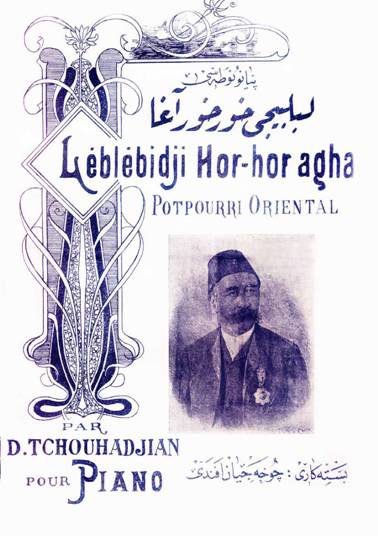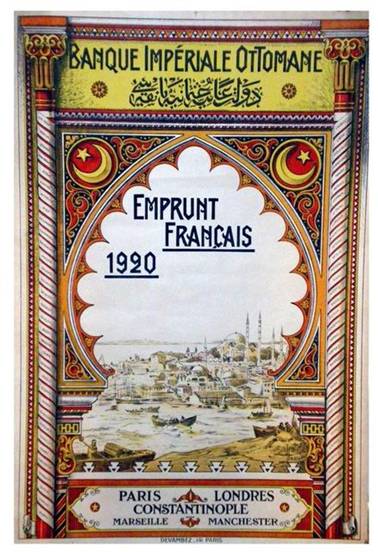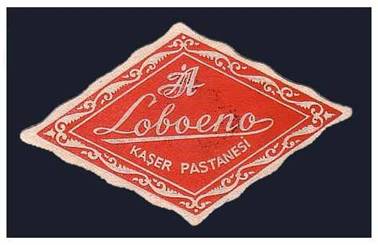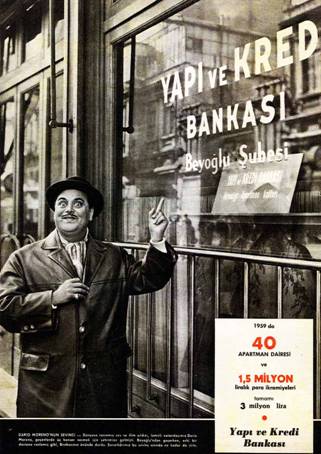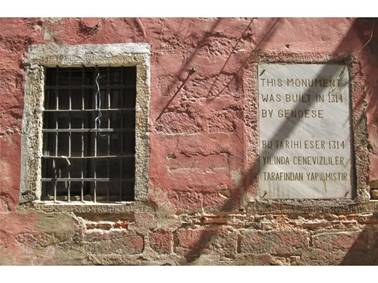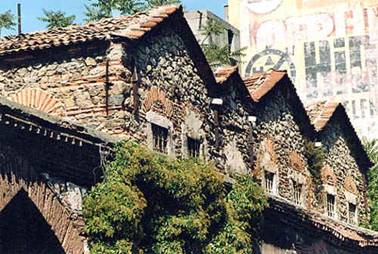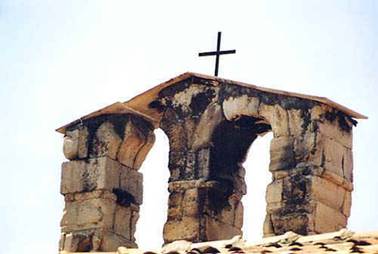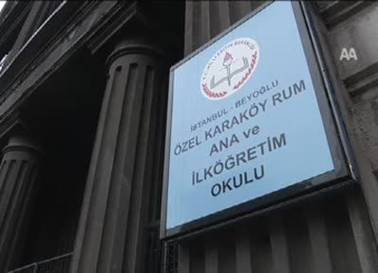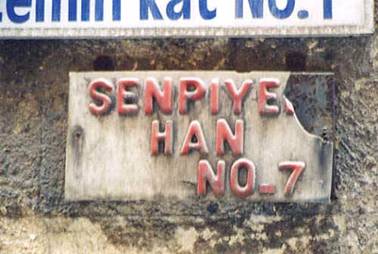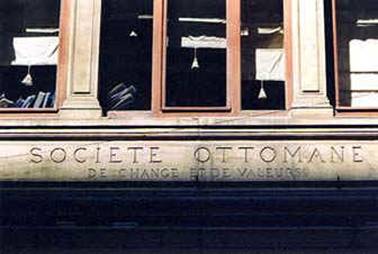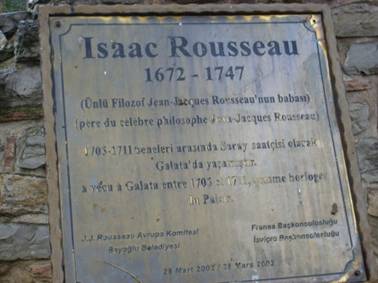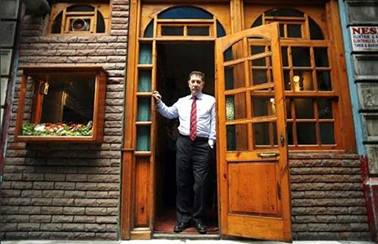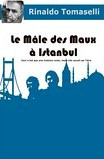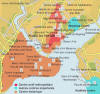|

L'ancienne tour des remparts génois est devenue
le symbole de la
municipalité de Beyoğlu
Un
des plus importants quartiers historiques
d’Istanbul est celui de Galata, au nord de
la
Corne d’Or, dans la
municipalité de Beyoğlu, nom
qui désignait autrefois toute la colline
incluant
le quartier de Péra
qui la domine. La
municipalité de Beyoğlu est bien plus vaste de
nos jours (voir la description détaillée).
|

Ville de Galata intramuros |
Galata était une ville séparée de Constantinople
à
l’époque byzantine et jusqu'à la fin de la
période ottomane. De nos jours, elle n’existe
plus officiellement et elle a été divisée en
sept quartiers : Arapcami, Emekyemez, Berketzade,
Müeyyedzade, Kemankeş, Hacımimi et Şahkule. Les
habitants continuent aussi d’utiliser les
anciens noms tels que
Perşembe Pazarı, Karaköy,
Şişhane,
Tünel, Kuledibi, etc, qui ont été
supprimés lors du redécoupage des municipalités.
Les origines de Galata sont très anciennes,
c’est même sur ce site que l’on a découvert les
premières traces d’habitation humaine de la
région remontant au cinquième millénaire avant
J.C. C’est aussi à cet endroit que
s’installèrent les tribus gauloises avant
d’envahir l’Asie Mineure et de s’établir
définitivement du côté d’Ankara (Angora) en
279-277 avant J.C. C’est une tribu gauloise, les
Galates, qui donnèrent leur nom à Galata d’une
part et à la Galatie (région d’Ankara mentionnée
dans la Bible par la Lettre aux Galates),
d’autre part.

Le
Galate mourant
du
Musée du Capitole,
Rome |
|
Les écrits byzantins en font régulièrement
mention pendant 1000 ans (!) sous le nom de
Sykais Peran
(Sycaena
des Latins),
mais il ne s’agissait qu’un d’un faubourg de
pêcheurs au pied de la colline.
|
|
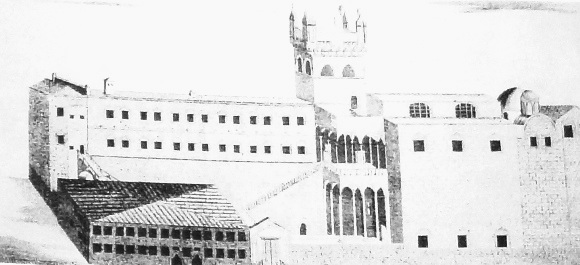
Monastère Saint-Benoît, église,
école et dispensaire au XVIe siècle
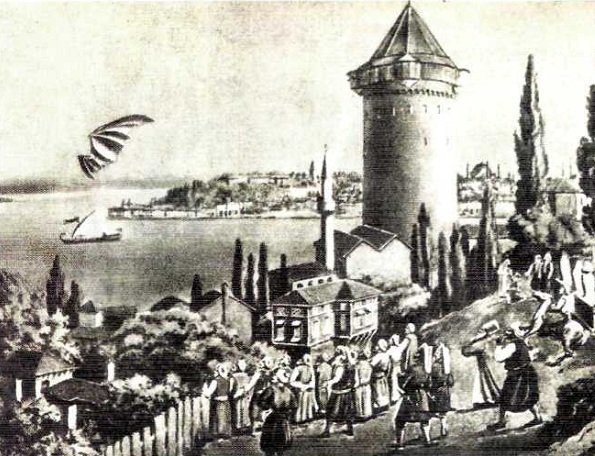
Vue de Galata en 1632 quand
Hezarfen Ahmed Çelebi s’envola
de la tour
avec des ailes qu’il
avait confectionné lui-même. Il toucha terre à
Üsküdar, le sultan le récompensa avant de
l’exiler à Alger
En 1261, lorsque les Paléologues récupèrent leur
capitale occupée par les Croisés et les
Vénitiens depuis 1204, ils eurent besoin de
l’aide des ennemis héréditaires de la
Sérénissime, la République de Gênes. L’alliance
byzantino-génoise aboutit à une première
concession accordée aux Génois pour bâtir une
cité sur l’autre rive de la
Corne d’Or.
Un premier établissement en bord de mer, entouré
d’une palissade, se développe par concessions
successives, vers la colline. La Tour du Christ
(actuelle
Grande Tour de
Galata) est implantée au point de
rupture de la pente et ainsi se constitue une
colonie génoise.
|

Remparts génois vers 1860 |
C’est une vraie ville occidentale, avec ses
murailles,
ses hautes
maisons en pierre,
ses rues rectilignes et parallèles, l’ensemble
est ponctué d’églises, notamment
Saint-Dominique
(dite Saint-Paul) et Saint-François
de part et d’autre de la cathédrale
Saint-Michel, en bordure de la place centrale où
se tient le marché.
Le monastère Saint-Pierre
et
Saint-Paul marque l’entrée ouest de la
(première) muraille, tandis que
Saint-Benoît est
planté à l’entrée est. La rue principale part de
la tour du Christ, passe devant les maisons
patriciennes accrochées à la pente et la
loggia du
podestat où se réunissent les
marchands, puis coupe la place de la cathédrale
pour descendre jusqu’à la mer, à l’endroit le
plus étroit de la Corne d’Or où s’effectue la
traversée vers Constantinople. C’est l’actuelle
rue
Perşembe Pazarı
le long de laquelle ont peut encore
voir les dernières “maisons franques”, des
maisons en pierre des XVIIe et XVIIIe siècles,
qui étaient habités par des étrangers (des
Francs), mais surtout l’ancien
tribunal génois et l’ancienne prison,
(XIIIe siècle).
|
Cette rue perpendiculaire à la mer est coupée
par le second axe important de Galata qui lui,
parallèle au rivage,
va de la porte de l’Arsenal à la porte de
Tophane
(Fonderie
de canon, actuel centre culturel
Mimar Sinan, Beaux-Arts).
Les Génois restent spectateurs du siège de
Constantinople par les Ottomans, et signent un
acte de reddition qui garantit non seulement
leurs personnes et leurs biens, mais leur donne
aussi le droit de conserver leurs églises et
leur accorde une quasi autonomie (jusqu’en
1914).

1900
Banque Ottomane |

1901
Le pont |

1920
Vue depuis Stamboul
|

1929
Au pied de la tour |

1930
Eglises russes |

1950
Place de Karaköy |

1930
Le pont |
|
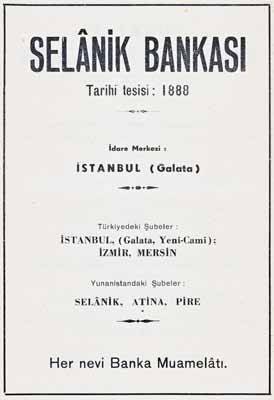 |
 |
|
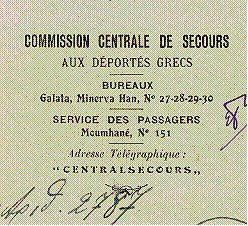 |
Les Ottomans transforment peu après l’église
Saint-Dominique (St-Paul) en mosquée, l’actuelle
mosquée des
Arabes ou Arap Camii, pour installer
autour un quartier d’ouvriers des chantiers
navals et surtout, les réfugiés
morisques
d'Espagne, mais ce sera l’unique empiètement
pour longtemps, les grandes mosquées bâties de
ce côté de la Corne d’Or (Sokollu
Mehmet Pacha en 1576,
Kiliç Ali Pacha
en 1580) l’étant à l’extérieur de la
muraille
de Galata.
Jusqu'aux dernières années de l’Empire ottoman,
Galata gardera toutes ses caractéristiques d’une
ville latine, voire italienne. Une aristocratie
issue de la bourgeoisie marchande s’y développe,
tandis que les gens de petites conditions y
vivent comme dans n’importe quelle ville
occidentale. Les tavernes y sont nombreuses où
le vin des vignes
de Péra y coule à flot. Les
cloches des églises ponctuent les occupations
des Latins et les voyageurs s’étonnent de voir
des processions de flagellants ou d’entendre
fêter bruyamment le carnaval.
C’est là
aussi
qu’on installe les ambassades chrétiennes au fur
et à mesure de leur arrivée dans la capitale, à
l’exception de celle de l’Empereur germanique,
le seul qui pourrait prétendre à l’égalité avec
le sultan, qui loge à Constantinople.
|
Galata nous a laissé à nous
autres francophones le mot
galetas. A l’origine, il
s’agissait des combles de la
grande tour des remparts (tour
de Galata). Par extension, le
mot galetas désigne un logement
plutôt miséreux (France) ou un
local de rangement (Suisse, est
de la France, Belgique), sous
les combles. |
|
|
 |

Une rue de Galata
vers 1890.
La charrette est tirée pas des buffles.
Sur la gauche, des tramways hippomobiles à
l’arrêt

Grand'Rue de Galata vers 1890

Le pont de Galata vers
1890
Aux yeux de l’administration ottomane, Galata se
présente sans doute comme un ghetto latin auquel
la méfiance est de rigueur. Les malheureuses
expériences byzantines ont entrainé une
suspicion légitime de la part des Ottomans.
Les
Levantins
de Galata sont des courtiers, les intermédiaires
privilégiés de l’Europe, et quand la puissance
de celle-ci s’affirme, Galata cesse d’être un
ghetto pour devenir le cœur économique de la
ville.
Les
banquiers
et
prêteurs
grecs,
arméniens
ou
juifs
du gouvernement,
s’y installent tout naturellement, et quand,
avec la guerre de Crimée en 1853, l’Empire
ottoman est placé sous tutelle économique de
l’Europe occidentale, c’est Galata qui aura sa
rue des banques en même temps que la première
municipalité
de l’empire.
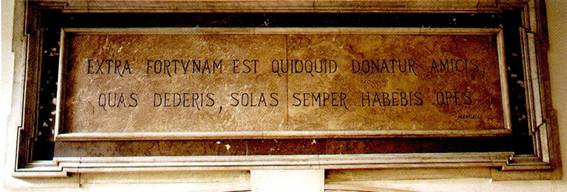
Pressée par les ambassadeurs étrangers d’établir
des services municipaux dans la capitale,
l’administration ottomane divise la ville en
quatorze cercles et instaure une
“municipalité-modèle”, pour le seul sixième
cercle, c’est-à-dire Galata et
Péra.
Le premier conseil municipal, composé de
chrétiens et de juifs, avec la participation à
titre consultatif d’étrangers établis dans la
ville, décide de paver les rues, de démolir les
murailles
et d’ouvrir une voie carrossable pour gravir la
pente entre le rivage et
la Grand-Rue de
Péra, (l’actuelle İstiklal Caddesi).
C’est sur cette rue dite des Banques,
aujourd’hui Voyvoda Caddesi, empruntée par les
premiers tramways hippomobiles (1869) que
s’installera la
Banque Impériale
Ottomane, organisme franco-anglais,
bientôt suivi par les autres établissements
bancaires comme celui des
Camondo,
bordé par l’élégant
escalier “baroque” du même nom qui
gravit la ruelle latérale. Un funiculaire, dit
aussi métro, le célèbre
“Tünel”
ou “tunnel”, relie depuis 1871 Galata à
Péra.
Au
début de son existence, Galata ne comptait que
des quartiers latins, mais au fil du temps et de
son expansion vers l’est et l’ouest avec de
nouvelles murailles, des Juifs caraïtes
s’installèrent aussi du côté de Karaköy et lui
donnèrent son nom (karayi köy), puis dès 1492,
des Juifs séfarades venus d’Espagne du côté
ouest et au sud-est de la grande tour. A l’est,
dans la partie la plus récente de la ville de
Galata, on y trouvait deux quartiers voués aux
catholiques orientaux (Grecs uniates et
Arméniens). A l’ouest, le quartier des musulmans
espagnols (Morisques). Plus tard, la zone de
Şişhane fut peuplée principalement par des
Maronites libanais et le haut de la ville, hors
les murs (quartier de Tünel), par des Juifs
ashkénazes de Russie. Les Marranes dits Juifs
italiens étaient aussi présents près de l’église
St Pierre et St Paul où se trouve toujours leur
synagogue.

Vue de la tour sur le Bosphore. Au
premier plan le lycée
français
Saint-Benoît sur la gauche |

Place de Karaköy dans les années 1940
avec
le Bon Marché (Bonmarşe) sur la
gauche |

Vue générale dans les années 1940 |

Lycée juif vers 1950 |

Eglise Surp Pirgiç en 1959
|

Karaköy vers 1960 avec la
synagogue russe sur la gauche |
Autre caractéristique occidentale, la “fuite” du
centre de Galata : les premiers immeubles de
rapport se déplacent de Galata à
Péra (Beyoğlu),
et ensuite au-delà de la place du
Taksim,
en laissant derrière eux des quartiers dégradés,
progressivement occupés par l’artisanat et les
migrants ruraux. Ce processus amorcé dès les
premières années de la République est déjà
accompli en ce qui concerne Galata, au cours des
années 50. Toutefois, l’ancienne cité génoise
conserve son site exceptionnel, sa situation de
passage obligé vers la vieille ville de Stamboul,
et abrite toujours les sièges des banques.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, Galata n’a pas
cessé d’avoir deux caractéristiques majeures :
être une ville dans la ville et une ville
occidentale dans une ville orientale. De nos
jours, tout n’a pas disparu, mais la migration
des habitants latins vers des quartiers plus
commodes à vivre (Gümüşsuyu, Pangaltı, Bomonti,
Nişantaşı, Şişli, etc.) a fondamentalement
changé l’esprit-même de Galata.
Une lente réhabilitation s’est amorcée dès les
années 1990. Elle n’est bien visible que depuis
le milieu des années 2000 et uniquement dans la
partie supérieure de Galata. La partie
inférieure est encore largement consacrée au
commerce, notamment à l’outillage (partie
sud-ouest) et à de petits ateliers dans la
partie sud-est où se tiennent aussi les
commerces liés aux quais qui accueillent tout au
long de l’année les passagers des croisières.
La partie supérieure, et notamment la zone en
dessus de la tour, a connu ces dernières années
un véritable engouement des classes moyennes
stambouliotes. Ainsi, de nombreux immeubles ont
été restaurés pour l’habitation et pour
l’hôtellerie. De petits cafés, des restaurants,
des boutiques et des galeries d’art se sont
ouverts. Des activités culturelles sont
fréquentes malgré les limitations municipales (AKP),
obstacle majeur d’un véritable développement.
Les restaurations d’immeubles commerciaux ou
non, ou des lieux de cultes non-musulmans, sont
pratiquement tous issues de fonds privés (la
Banque Ottomane,
le
musée Juif,
la
synagogue
Schneider, la
Maison Camondo,
le
passage Salonique,
l'église
St-Benoît,
la prison
anglaise, etc.). La municipalité (AKP),
se bornant à donner des directives et à sortir
des projets mégalomanes dont certains pourraient
bien défigurer le quartier historique de Galata
à jamais : projet du nouveau port de Karaköy ou
le réaménagement des chantiers navals.

Quais de Galata |

Caravansérail
Rüstem Pacha |

Ancienne
école hongroise |

Sur le pont |

A St Pierre et St Paul |

Cité Française |

Ancien hôpital de la
Marine anglaise |

Banque ottomane |

Panorama de la tour de Galata
|