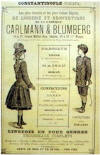|
Si le voyageur d'aujourd'hui ne s’aperçoit pas
tout de suite que la langue française occupe une
place importante dans l'histoire d'Istanbul,
c'est que son rôle s'est cruellement réduit
depuis quelques années.
Le français était une des langues les plus
utilisées dans l'Empire ottoman. Au début de ce
siècle, des dizaines de journaux paraissaient en
français, les rues de la ville étaient indiquées
en deux langues et toute l'administration était
bilingue.
L'expansion du français c'est faite à
partir de la fin du XVe siècle, quand les
Juifs
chassés d'Espagne ont installé
la première
imprimerie en 1494. A cette époque et
jusqu'en 1928, le turc s'écrivait en caractères
arabes. Les Ottomans, ne voulant pas qu'on
imprime les caractères sacrés de l'Islam,
laissèrent les Juifs utiliser les caractères
hébraïques et les caractères latins. On commença
donc à utiliser le français qui était, (et est
toujours), la principale langue parlée et écrite
en Europe.
Au XVIIe ce fut d'abord les
Arméniens
et ensuite les
Grecs
qui adoptèrent l'imprimerie et c'est seulement
au XVIIIe siècle que les musulmans laissèrent de
côté leurs vieux préjugés. C'était déjà trop
tard pour l'expansion de la langue ottomane. Le
français s'était développé dans tout l'Empire.
Aussi bien en Grèce qu'en Bulgarie ou dans les
Balkans, qu'en Syrie, en Egypte ou en Cilicie.
L'influence de la France (capitulations =
colonialisme économique) et la francophilie de
certains sultans contribuèrent aussi à
l'utilisation du français.
Dès le XVIIIe siècle, des écoles religieuses
s'implantèrent dans tout l'Empire. Dans le
Constantinople de l'époque, à
Smyrne,
Antioche,
Salonique, Trébizonde et la plupart des villes,
toute la bourgeoisie, les nobles et les
marchands parlaient le français, alors qu'une
communauté française d'origine, s'y développait
en faisant du commerce : les Levantins, (noms
célèbres :
André Chénier,
Edouard Balladur,
Dario Moreno,
Henri Langlois,
Alexandre Vallaury, Dalida).
Vers les années 1920, les opératrices des PTT,
ne parlaient qu'en français, il n'était pas même
possible d'avoir des renseignements en turc ! De
même les annuaires étaient seulement en
français.
En 1928,
Atatürk
réforma la langue et l'écriture. On adopta les
caractères latins et ainsi la langue turque
s'ouvrait à l'Europe occidentale et au progrès.
Pour faire adopter une nouvelle écriture à tout
un peuple, le seul moyen efficace était de tout
simplement interdire l'ancienne. Pour les autres
langues utilisées dans la nouvelle république,
on laissa un peu plus de liberté, mais on
officialisa seulement la langue turque moderne.
Les plaques et les noms des rues changèrent. Les
pancartes des commerçants Levantins, Grecs et
Arméniens étaient désormais rédigées en turc et
les billets de banque ne présentaient plus
qu'une seule langue nationale. Le passeport
turc, quant à lui, était toujours en turc et en
français, (aujourd'hui, en anglais).
Le nom de Constantinople avait survécu jusque là
(1930), comme celui de Smyrne, (Izmir),
Trébizonde, (Trabzun), Antioche, (Antakya),
Brousse, (Bursa) ou Sébastée, (Sivas).
Il était temps de réparer cette anomalie. On
désignait alors, Constantinople pour l'ensemble
des quartiers de
Galata
et
Péra,
(Beyoğlu),
Phanar,
(Fener),
Balat,
Scutari, (Üsküdar),
Chalcédoine, (Kadıköy),
Psamathia, (Samatya),
Stamboul, (Cağaloğlu
et
Beyazıt),
etc. On décida de prendre le nom de Stamboul
pour remplacer le précédent qui faisait un peu
trop byzantin. Le nom même de Stamboul venait du
grec (Eis tan poli), et qui signifiait :
"dans la ville", sous-entendu, "dans la vieille
ville". Comme à l'époque, c'est le français
qu'on utilisait pour l'écriture latine, on
écrivait phonétiquement : Stamboul. Dans la
toute nouvelle langue, cela devint : Stanbul.
Eh oui, manque le "i". Et bien c'est simple. En
turc moderne, il n'est pas possible, pour
l'harmonie vocale, de commencer un mot par "st".
Ainsi, station devient "istasyon"...,
donc Stanbul, Istanbul. Notons avec joie,
que notre langue a contribué au nom même de la
ville.
De la gloire passée du français à Istanbul, il
reste quelques reliques, comme le nom des
passages, (Cité
de Péra,
Cité Alléon,
Cité Roumélie,
Cité d'Alep).
Les vrais Stambouliotes et surtout la
bourgeoisie, apprennent encore la langue de
Voltaire dans de prestigieuses écoles comme
Ste Pulchérie,
St Michel,
St Benoît,
Notre-Dame-de-Sion ou
St Joseph.
Galatasaray,
lycée national turc, dont l'enseignement est en
français, est certainement l'un des meilleurs,
un grand nombre de parlementaires et diplomates
sortent de cet établissement. D'autres écoles,
lycées et universités turques diffusent notre
langue, (Beyazıt, Yıldız, Marmara, etc.).
Les Juifs
se transmettent de père en fils le français et
ainsi 90 % d'entre eux le parlent. Les autres
minoritaires, comme les
Grecs,
Arméniens,
Chaldéens,
etc. savent généralement eux aussi le français.
On trouve en ville plusieurs instituts français,
un hôpital, (La Paix), deux maisons de retraite,
un orphelinat, des librairies, des
bibliothèques, une troupe de théâtre et des
associations.
L'Union Française
se trouve à Péra, comme l'Association
Démocratique des Français de l'Etranger.
Un nombre peu élevé, comparé au passé, de
Levantins
d'origine française, réside généralement entre
Péra et
Pancaldi
et autres quartiers du Nord d'Istanbul, et aussi
du côté de
Kadıköy
et Moda. Dans la plupart des quartiers, du
Bosphore
à
Yeşilköy
(San Stefano), en passant par la côte asiatique,
on trouve
des églises
françaises.
St-Louis,
la chapelle de
Faik Pacha
et la
cathédrale St
Esprit, pour
Péra
seulement. De nombreux ordres religieux se
partagent les paroisses de la ville.
Le
Centre Culturel
Français se trouve au cœur même de
Péra, le quartier le plus francophile de la
ville. Malheureusement ses activités sont très
limitées. Restrictions budgétaires obligent.
S'il y avait une réelle motivation pour le
développement de la langue, nous pourrions
facilement en percevoir les résultats. Les
pancartes des
musées
sont toujours qu'en turc et en anglais, comme
certaines visites accompagnées obligatoires,
(harem de
Topkapı,
palais de
Dolmabahçe, etc.). Le journal du soir
sur la chaîne nationale est en anglais et en
allemand. Le dernier journal francophone "Orient
Express" a disparu déjà depuis quelques années,
il y a qu'une radio francophone belge en ville,
le câble n'offre que deux chaînes, la
désastreuseTV5 et MCM, (donc pas françaises),
... Voilà le soutient que l'on peut offrir à
une ville qui crie sa francophilie.
Les Turcs
aiment toujours notre langue, (on peut estimer
entre 500 et 750 000 le nombre des francophones
à Istanbul), même si aujourd'hui l'anglais
essaie de prendre sa place, mais pour encourager
la diffusion du français, il faudrait que la
Turquie entre dans la Francophonie, tout comme
l'ont fait les anciens pays dépendant de
l'Empire ottoman; la Roumanie, la Moldavie, la
Macédoine, la Bulgarie, le Liban et l'Egypte.
|